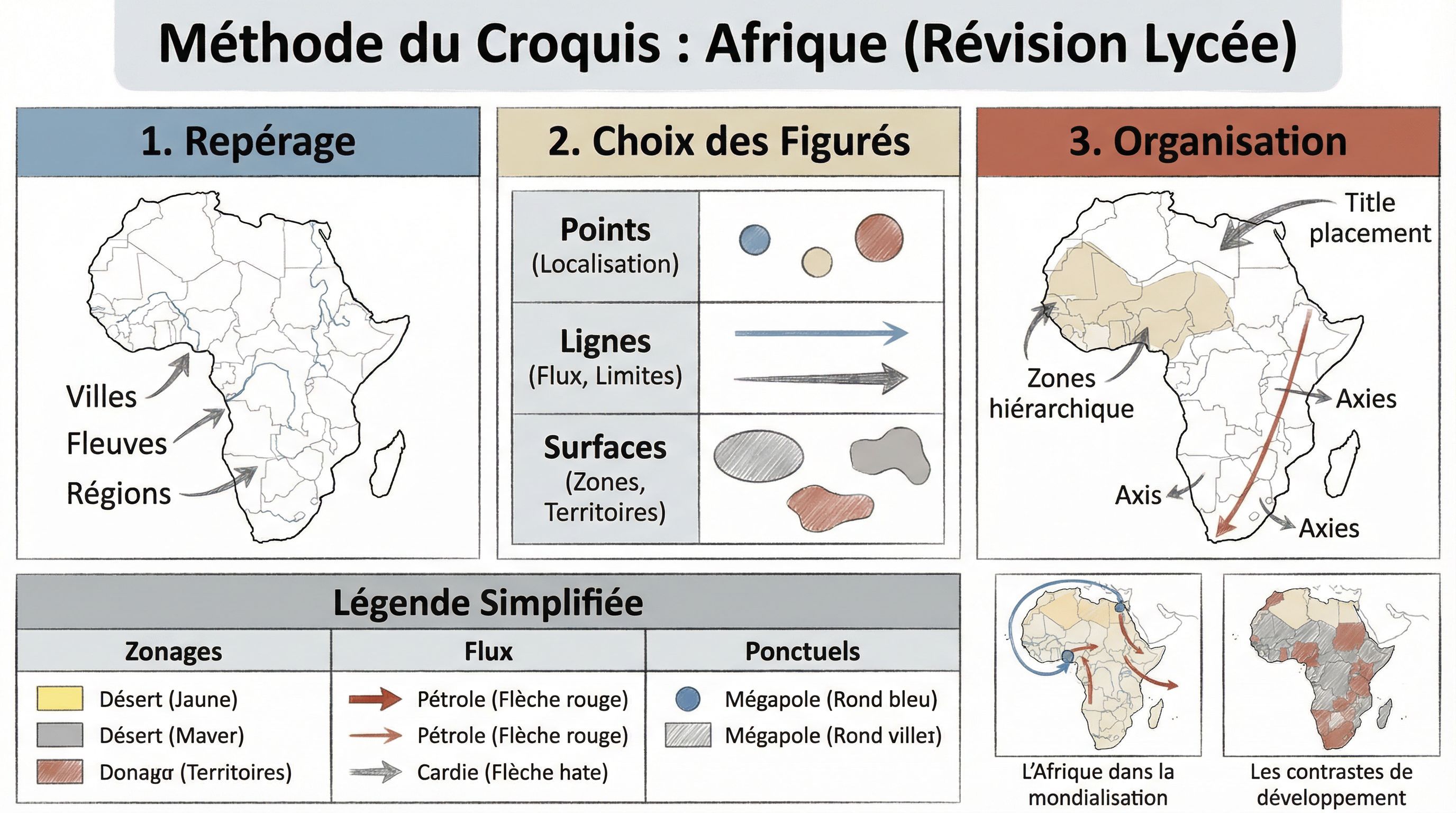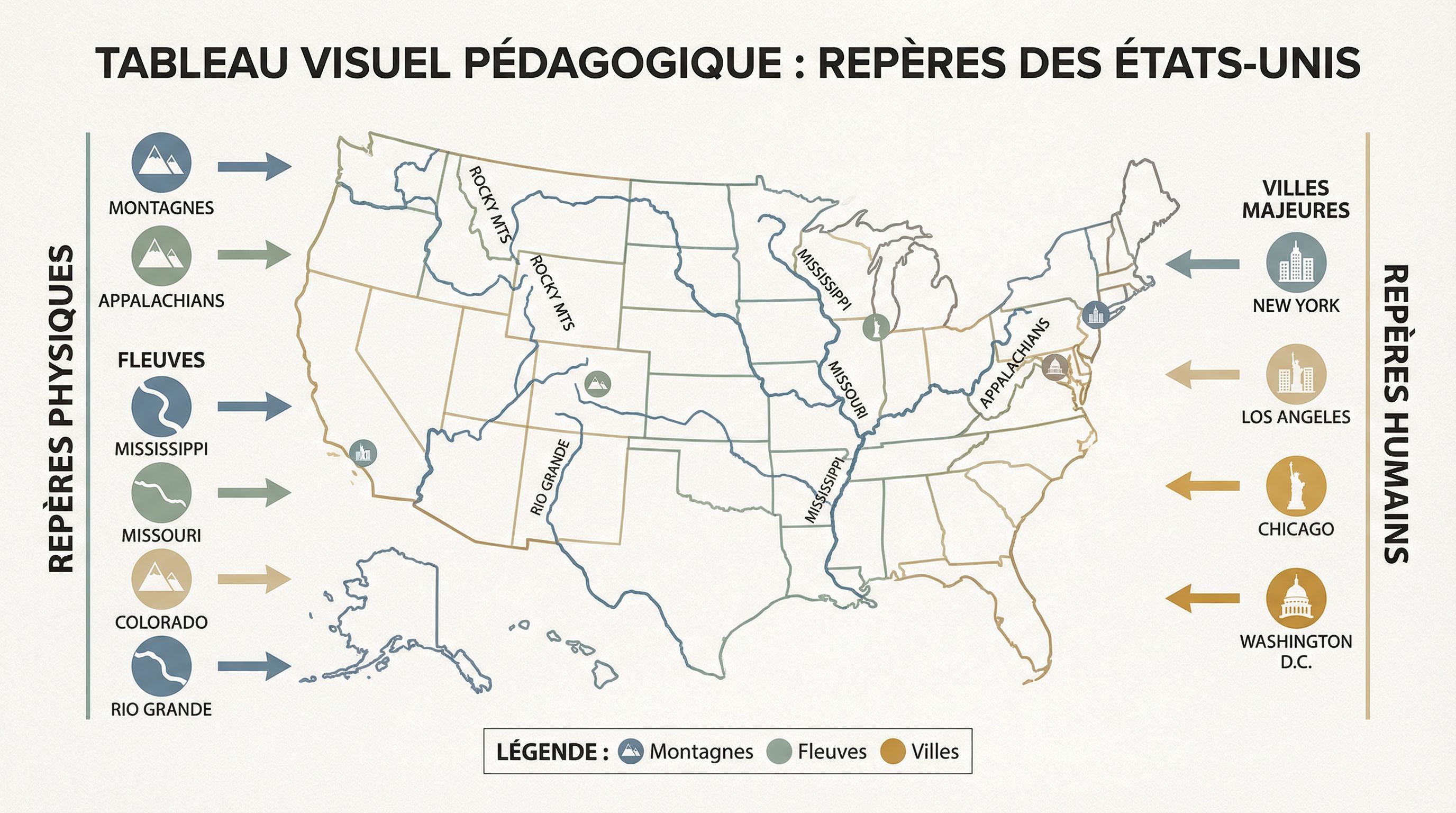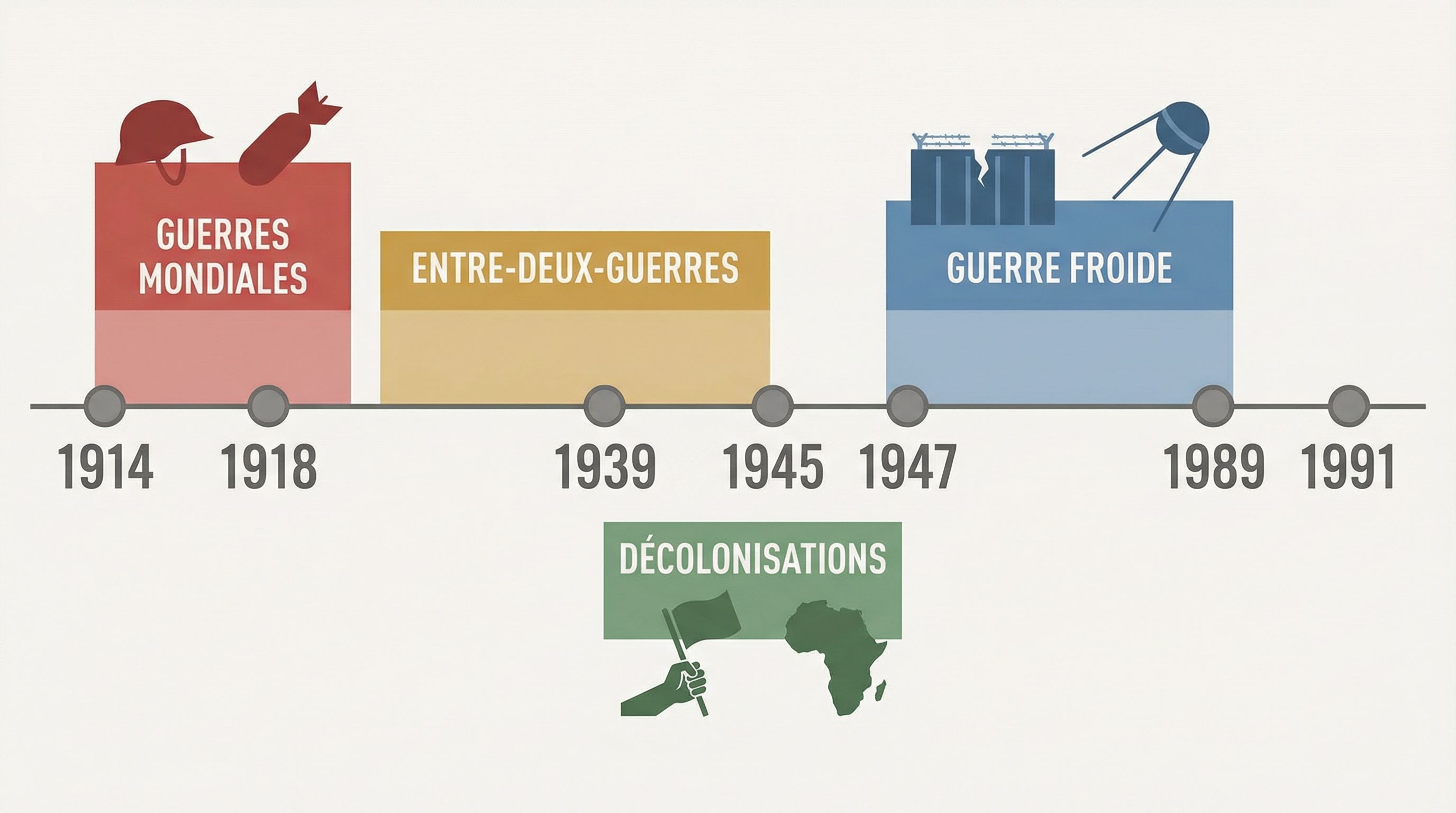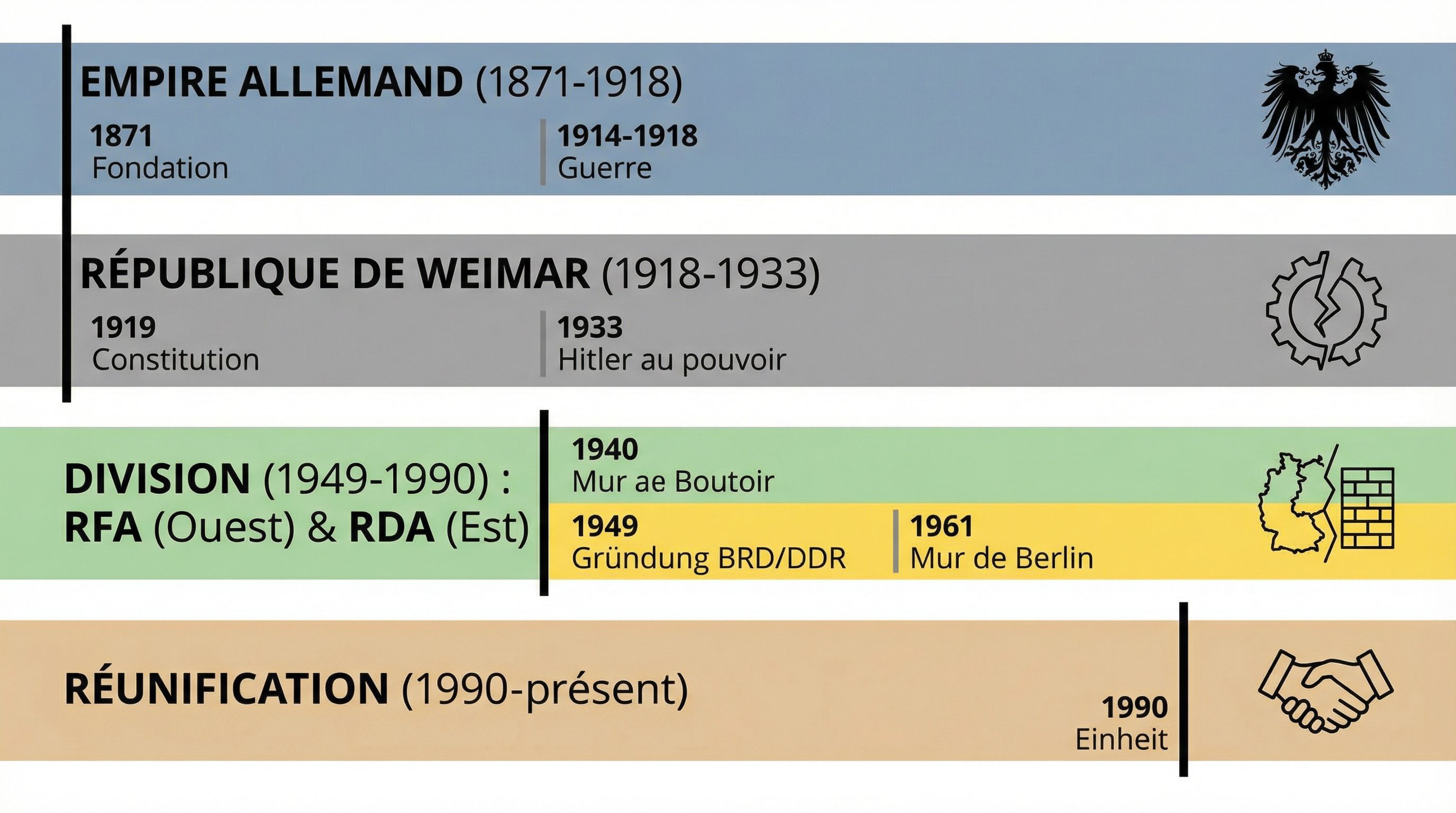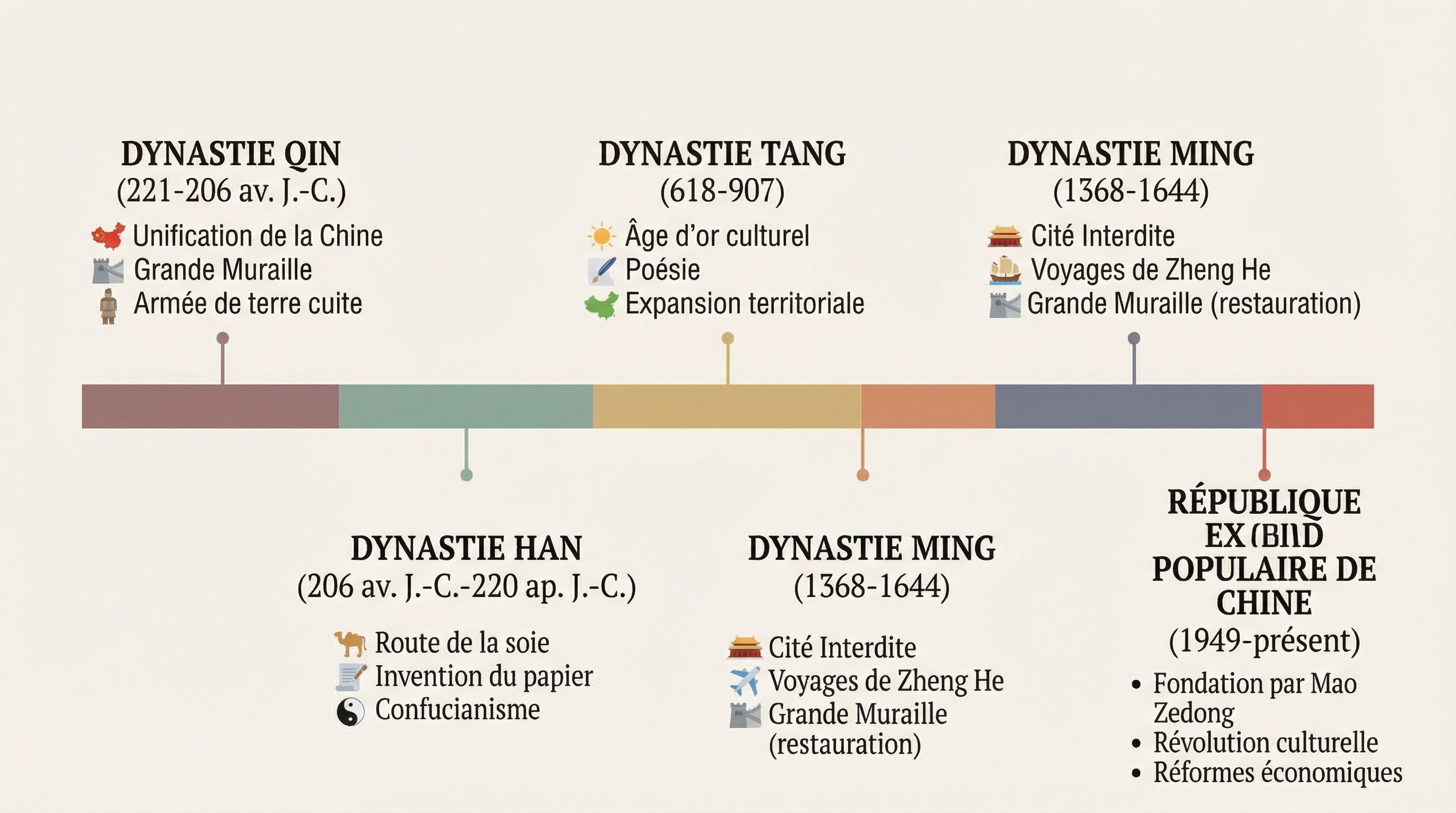Vie Lycéenne & Bons Plans
Vie Lycéenne & Bons Plans
Manger sainement sans se ruiner au lycée ou à la fac
Vous pensez que bien manger coûte forcément cher ? Beaucoup de lycéens et d’étudiants partagent ce sentiment, surtout quand chaque...